Programme du:
25 Mai au 28 Juin 2011
25 Mai au 28 Juin 2011
Programme téléchargeable PDF
Doc Renoir New Prog 8P
****
CINE BISTRO PHILO
Jeudi 26 Mai 18h30
Gare à la Bête
Partenariat MJC / médiathèque Louis Aragon / Renoir / librairie L’Alinéa / Vladimir Biaggi
Animé par
Vladimir BIAGGI
Jeudi 26 Mai 18h30
Gare à la Bête
Partenariat MJC / médiathèque Louis Aragon / Renoir / librairie L’Alinéa / Vladimir Biaggi
Animé par
Vladimir BIAGGI
Le poulpe, sous toutes ses formes, est dégusté sur les rives de la Méditerranée et bien au-delà ! Comment passe-t-on du poulpe à la pieuvre ? La pieuvre : la bête, le monstre -forme et informe - habite les fonds marins et hante les grands thémes romanesques (de Victor Hugo à Jules Verne), mais aussi le cinéma, les arts plastiques, la bande dessinée, la vie sociale (les mafias, les nouveaux réseaux médiatiques...) et politique (la pieuvre alors est aussi bien stalinienne que fasciste, jésuite et islamiste etc.). Ce bistrot-philo (animé par Vladimir Biaggi auteur de "Poulpes, seiches et calmars ; mythes et gastronomie" éd. Jeanne Laffitte) tentera de cerner les métamorphoses de la pieuvre pour examiner la bête dans tous ses états en nous interrogeant sur l'état de ce mythe.
FILM SURPRISE
Indices :
La première signification du titre est organisme vivant qui héberge un parasite. Compris ainsi, ce titre donne l'impression que le film traite de quelque chose de biologique ou de mutation. L'autre sens de ce mot personne qui offre l'hospitalité, suggère la signification sociopolitique du film.
Tarif débat, buffet, film : 8 € - 7 € (adhérents)
**************
Cinéma et Histoire
Mardi 7 Juin 20h30
La jeunesse au cœur de l’Histoire
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme
Mardi 7 Juin 20h30
La jeunesse au cœur de l’Histoire
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme
Marc Rothemund
Allemagne, 2006, 2h00
Avec : Julia Jentsch, Alexander Held…
Berlin 2005 : Ours d'argent du Meilleur réalisateur, Meilleure actrice et Prix du Jury œcuménique
A Munich, le 18 février 1943, Sophie Scholl et son frère Hans sèment dans les couloirs d'une université des centaines de tracts dénonçant la stratégie apocalyptique de Hitler et la mort de milliers de jeunes Allemands sacrifiés à Stalingrad. Une opération risquée, mais joyeuse et pleine d'espoir, du groupuscule secret que ces deux « résistants de l'intérieur » ont fondé avec un autre étudiant, La Rose blanche. Le trio est arrêté, jugé et condamné à mort. Le 22 février, Sophie Scholl est décapitée.
A 21 ans.C'est toute la violence de ce destin que fait surgir le cinéaste Marc Rothemund, mais aussi sa force admirable. Grâce à des archives accessibles depuis quelques années seulement, ce jeune cinéaste allemand a pu donner une place centrale à l'interrogatoire de Sophie Scholl mené par la Gestapo. Il fait ainsi vivement résonner la voix de son héroïne, son combat, son courage, dans une mise en scène dépouillée.
La ROSE BLANCHE :


Dossier de Presse :

************************
CINE DEBAT JEUDI 16 JUIN 20H30
En partenariat avec
l’Association France Amérique Latine
Débat animé par
Jean-Marie PAOLI

Carlos César Abélaez
Colombie, 2010,1h33
La Pradera - Un village dans la Cordillère des Andes en Colombie… Manuel a un vieux ballon avec lequel il joue chaque jour au football avec les garçons de son âge. Pour ses 9 ans, Ernesto, son père, lui offre un nouveau ballon et une paire de gants de gardien de but. Un jour, Manuel et Julian, son copain de toujours, envoient le ballon sur un champ de mines par inadvertance. Malgré le danger, toute la bande de gamins décide d’aller le récupérer coûte que coûte… Derrière les jeux d’enfants, les signes d’un conflit armé gangrènent la vie quotidienne, la plupart des habitants étant poussés inexorablement à quitter les lieux.

Tourné avec des acteurs non professionnels, "Les Couleurs de la montagne" décline avec
modestie l'art de peindre l'irrespirable sans imposer l'horreur plein cadre. La tyrannie quotidienne est ici suggérée à hauteur de pinceaux d'enfants. Le Monde

Tourné avec des acteurs non professionnels, "Les Couleurs de la montagne" décline avec
modestie l'art de peindre l'irrespirable sans imposer l'horreur plein cadre. La tyrannie quotidienne est ici suggérée à hauteur de pinceaux d'enfants. Le Monde

**********************
REGARDS SUR LE CAMBODGE
Vendredi 24 JUIN 20h30
Dans le cadre de l’ Exposition de
MICHELINE DULLIN
Regards sur le Cambodge 1958 – 1964
En partenariat avec L’association Philux et les Editions Images en Manoeuvre

En présence de
MICHELINE DULLIN
et de
HOC PHENG CHHAY
Président du Comité des Victimes des Khmers Rouges
La ville de Martigues propose du 28 mai au 16 septembre un regard sur le Cambodge de la période Sihanouk, à travers les photographies de Micheline Dullin, ainsi qu’un rappel de l’horreur des années Khmers rouges grâce aux films de Rithy Panh.
Micheline Dumoulin dit Dullin (née en 1927) reporter officielle du Prince Sihanouk, a voyagé à travers le Cambodge. Ses clichés témoignent d’une époque heureuse et de grands chantiers en construction. Parallèlement, il y a ce que l’on pourrait nommer les « images quotidiennes» qui rendent compte d’une rencontre avec un pays et ses habitants, à travers le regard d’une artiste touchée par la grâce d’un instant, d’un regard, d’une lumière... Micheline Dullin vit actuellement à Martigues.
Rithy Panh (né en 1964) est interné à l’âge de 11 ans, dans les camps khmers de réhabilitation par le travail. Quatre ans plus tard, il parvient à s’échapper et s’installe en France. Devenu réalisateur, Il a dédié la plupart de ses films à son pays d’origine, traumatisé par un génocide d’une violence extrême. Site 2, La Terre des âmes errantes, Les Gens de la rizière et Un soir après la guerre. S21, La Machine khmère rouge frappe les consciences de tous les pays. En 2005, Rithy Panh réalise Les Artistes du théâtre brûlé puis Le Papier ne peut pas envelopper la braise sur le sort des femmes prostituées au Cambodge. Rithy Panh se consacre au Centre Bophana "Centre de Ressources Audiovisuelles", qui permettra aux cambodgiens de consulter les archives collectées sur le Cambodge.
Les Artistes du théâtre brûlé
Rithy Panh (France-Cambodge, 2005, 1h25)
Les acteurs évoluent dans les décombres d'un théâtre de Phnom Penh. Leur vie, leur mémoire, leur histoire, leur être même s'emparent du film, avec la complicité active d'un cinéaste qui est des leurs. Rithy Panh s'est engagé dans une œuvre de construction mémorielle par le cinéma, là où les hommes politiques ont jusqu'à présent échoué à élaborer un récit commun sur le génocide cambodgien. Les Artistes du théâtre brûlé, rappelle que cette mémoire se construit aussi sur une scène, par la mise en jeu des corps. Interprétation du réel et documentaire s'entremêlent lorsque Rithy Panh en arrive à la question de la mémoire. Comme dans S21 où il demandait aux anciens bourreaux de mimer leurs gestes quotidiens de tortionnaires, il demande maintenant à une ancienne prisonnière de situer les lieux de ses tortures sur une maquette d'architecte ou de scénographe. Le lieu vidé ou représenté aide la mécanique de la mémoire à se remettre en marche, alors que, seule, la parole est amnésique. Thérapeutique dans ses procédés, le cinéma de Rithy Panh est absolument salutaire.
Centre Bophana :
L'absence: À travers le regard de sa famille restée au Cambodge, le réalisateur franco-khmer nous emmène sur un parcours chargé d’émotions. Trente ans après le départ de son père, il découvre un autre Cambodge profondément marqué par son histoire. Ces témoignages décrivent un pays de contradictions qui se tourne vers l’avenir.
Festival Cinémekong (Phnom Penh), Festival International du Film d'Amiens (FIFA), Festival Filmer à tout prix (Bruxelles), Festival du Film de Famille (Annonay), Coup de coeur à la Péniche cinéma (Paris - La villette) Une production du centre Bophana avec l'aide de Rithy Panh
Festival Cinémekong (Phnom Penh), Festival International du Film d'Amiens (FIFA), Festival Filmer à tout prix (Bruxelles), Festival du Film de Famille (Annonay), Coup de coeur à la Péniche cinéma (Paris - La villette) Une production du centre Bophana avec l'aide de Rithy Panh
*************************
Cannes, c’est chaque année une extension du domaine de la vulgarité, du luxe autosatisfait, des vigiles veillant à la bonne séparation des riches oisifs et des badauds du tiers état, de la mentalité open bar et des zombis enterrés sous des tonnes de capsules Nespresso. Mais tout ce merdier peut soudain se mettre à graviter comme une déchetterie cosmique en orbite autour d’un astre pur, filant sa trajectoire dans la cathédrale brisée du Palais du festival.
Au bout de dix minutes de projection matinale de The Tree of Life, les pupilles dilatées, on sait qu’on s’en souviendra toute sa vie. Ce n’est évidemment pas un film comme les autres, et Terrence Malick est devenu, depuis la mort de Kubrick, le seul cinéaste ayant fondé son royaume altier et solitaire, farouchement mutique et inaccessible aux médias. Nul mieux que lui ne peut occuper la place de l’artiste barbu et ténébreux capable d’arracher aux studios la plus totale liberté d’action, et les moyens considérables pour parvenir à ses fins.
Un an de recherche sur les effets spéciaux, 10 000 garçons auditionnés pour trouver le trio des frères occupant la partie fifties du récit, deux ans de montage (avec cinq chefs monteurs !), annoncé à Cannes en 2010 puis retiré à la dernière minute parce que pas prêt, The Tree of Life transporte avec lui sa légende de fresque poétique grandiose mais aussi de casse-tête maudit et de prière impossible à écrire ou proférer.
Amplitude des pôles. Malick a des ambitions pour le cinéma qui ne coïncident pas forcément avec l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui, où des formes plus simplement rêveuses d’un Apichatpong Weerasethakul ou expérimentales brutes du dernier Lynch suffisent à étancher notre soif de sublime. Chez lui, l’amplitude des pôles entre lesquels son inspiration entend naviguer n’a cessé d’augmenter de film en film : les voix les plus intérieures et l’oeil le plus transcendant, l’hypersensibilité perceptive aux moindres nuances du monde ambiant, le plus charnel, le plus lumineux, et des poussées de delirium tremens métaphysique où le cinéaste semble entrer en contact direct avec le big-bang et/ou dieu en personne.
(…)Le film se situe bien sur deux époques, les années 50, avec Brad Pitt, et les années 2000, avec Sean Penn. Ce dernier n’était pas à la conférence de presse, il est difficile de savoir si son personnage a été raboté au fil des remontages successifs, mais le fait est que sa partie est réduite à la portion congrue tandis que le film s’attarde sur les relations conflictuelles dans une petite ville du Texas entre O’Brien (Pitt) et ses trois fils dont l’un meurt bientôt, noyé.
Ex-officier aux méthodes d’éducations rigides, O’Brien entend endurcir ses rejetons sous l’oeil timoré de son épouse (Jessica Chastain). Il ambitionnait une carrière de grand musicien et a fini simple cadre. Son volontarisme carriériste dans l’Amérique conquérante de l’époque est contrebalancé par le jugement négatif de son ainé, Jack. On voit monter la haine dans le regard bleu-sombre de l’enfant, qui découvre avec ses amis le plaisir de la destruction et la désobéissance.
Rhapsodie. Comme toujours chez l’auteur des Moissons du ciel et du Nouveau Monde, le style de la chronique est entièrement retravaillé pour lui donner une inflexion élégiaque. Les événements anodins, les cris, la joie des jeux, le tragique de l’accident, la répétition des repas, les échappées frondeuses : tout advient et disparaît comme une récapitulation éternisée. On pense aux techniques narratives de Tolstoï, avec lequel Malick partage un certain mysticisme et une aura de gourou.
Comme dans Anna Karénine, les personnages sont plongés dans un clair-obscur vibrant, chaleureux et menaçant. Nous entendons, à la faveur de l’omniscience du créateur, leurs questionnements intérieurs (et ici, la rhapsodie des voix off est somptueuse), mais nous touchons aussi du doigt le mystère profond de leur destin guidé par quelque chose de plus grand qu’eux. Le regard se porte au cœur des entrailles vives, file hagard à travers les grottes du temps et s’échoue aux bords d’un abîme pulvérulent, où images et sons n’ont plus lieu d’être.
Depuis toujours, chaque plan de Malick est un capteur branché sur des forces telluriques, divines, verticales. Mais jamais il n’avait encore franchi le pas d’une représentation littérale de cet au-delà inhumain. Aidé par Douglas Trumbull, auteur des effets spéciaux de 2001, il plonge le spectateur dans un long bain sidéral, mélangeant prises de vue réelles (cascades, volcans, vues sous-marines…) et bidouillage de peintres post-Dali de l’ère iMac : «On a utilisé des produits chimiques, de la peinture, des teintures fluorescentes, de la fumée, des liquides, du dioxyde de carbone…» explique Trumbull dans le dossier de presse. (…) Peu importe, la tambouille philosophique phosphorescente de Malick n’a jamais été ce qu’il y avait de bouleversant chez lui. Non, c’est bien une fois encore la confiance totale, intransigeante et jupitérienne dans l’acte de filmer à perdre haleine, versant l’un dans l’autre tels deux philtres noirs les univers visibles et invisibles jusqu’au point d’éblouissement final. DIDIER PÉRON
******
On sait très peu de choses de Terrence Malick, qui s'est toujours entouré de mystère. Après des études très brillantes à la célèbre université de Harvard, il entame une carrière de journaliste et travaille notamment pour Life et le New Yorker. Attiré par le cinéma, il intègre le Centre d'Etude Avancées de l'American Film Institut, où il rencontre George Stevens Jr. et Mike Medavoy qui lui confie la réécriture du scénario de L'inspecteur Harry. Cette entreprise qui ne donnera rien au final lui fait sauter le pas de la réalisation. Il a alors 28 ans.
Son premier film, La balade sauvage (1974), est unanimement salué par la critique qui dira même que c’est le "film le plus maîtrisé depuis le Citizen Kane d' Orson Welles". Il y met en scène de nouveaux talents comme Martin Sheen et Sissy Spacek.
Quatre ans plus tard, il signe un chef-d’œuvre avec Les Moissons du ciel, qui révèlera le jeune Richard Gere. Ensuite c’est le silence radio : Terrence Mallick s’exile et se terre dans le mutisme le plus total, un silence qui durera... 20 ans.
On raconte ça et là qu’il aurait participé au scénario de Will Hunting, mais son retour est officiel en 1999 avec La Ligne Rouge, film adapté du roman de James Jones, et dont le casting donne le vertige : Sean Penn, Woody Harrelson, George Clooney, Adrien Brody, Nick Nolte, John Travolta, Jim Caviezel...
Déception pourtant, la sortie du Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg au même moment eclipsant le nouveau film de Malick. Il faut attendre encore sept ans pour voir de nouveau un film du réalisateur, avec Le Nouveau monde, mettant en vedette Colin Farrell.
Fidèle à sa culture du secret, Terrence Malick ne laisse pas filtrer grand chose de son projet suivant, Tree of Life, réunissant à l'écran Brad Pitt et Sean Penn, attendu pendant deux ans, changeant régulièrement de synopsis - de l'épopée cosmique embrassent toute l'histoire humaine au parcours du jeune Jack découvrant les affres de la vie en passant par l'animation de dinosaures. Espéré à Cannes en 2010, il est finalement prêt pour l'édition 2011 où il remporte la Palme d'Or.
Au bout de dix minutes de projection matinale de The Tree of Life, les pupilles dilatées, on sait qu’on s’en souviendra toute sa vie. Ce n’est évidemment pas un film comme les autres, et Terrence Malick est devenu, depuis la mort de Kubrick, le seul cinéaste ayant fondé son royaume altier et solitaire, farouchement mutique et inaccessible aux médias. Nul mieux que lui ne peut occuper la place de l’artiste barbu et ténébreux capable d’arracher aux studios la plus totale liberté d’action, et les moyens considérables pour parvenir à ses fins.
Un an de recherche sur les effets spéciaux, 10 000 garçons auditionnés pour trouver le trio des frères occupant la partie fifties du récit, deux ans de montage (avec cinq chefs monteurs !), annoncé à Cannes en 2010 puis retiré à la dernière minute parce que pas prêt, The Tree of Life transporte avec lui sa légende de fresque poétique grandiose mais aussi de casse-tête maudit et de prière impossible à écrire ou proférer.
Amplitude des pôles. Malick a des ambitions pour le cinéma qui ne coïncident pas forcément avec l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui, où des formes plus simplement rêveuses d’un Apichatpong Weerasethakul ou expérimentales brutes du dernier Lynch suffisent à étancher notre soif de sublime. Chez lui, l’amplitude des pôles entre lesquels son inspiration entend naviguer n’a cessé d’augmenter de film en film : les voix les plus intérieures et l’oeil le plus transcendant, l’hypersensibilité perceptive aux moindres nuances du monde ambiant, le plus charnel, le plus lumineux, et des poussées de delirium tremens métaphysique où le cinéaste semble entrer en contact direct avec le big-bang et/ou dieu en personne.
(…)Le film se situe bien sur deux époques, les années 50, avec Brad Pitt, et les années 2000, avec Sean Penn. Ce dernier n’était pas à la conférence de presse, il est difficile de savoir si son personnage a été raboté au fil des remontages successifs, mais le fait est que sa partie est réduite à la portion congrue tandis que le film s’attarde sur les relations conflictuelles dans une petite ville du Texas entre O’Brien (Pitt) et ses trois fils dont l’un meurt bientôt, noyé.
Ex-officier aux méthodes d’éducations rigides, O’Brien entend endurcir ses rejetons sous l’oeil timoré de son épouse (Jessica Chastain). Il ambitionnait une carrière de grand musicien et a fini simple cadre. Son volontarisme carriériste dans l’Amérique conquérante de l’époque est contrebalancé par le jugement négatif de son ainé, Jack. On voit monter la haine dans le regard bleu-sombre de l’enfant, qui découvre avec ses amis le plaisir de la destruction et la désobéissance.
Rhapsodie. Comme toujours chez l’auteur des Moissons du ciel et du Nouveau Monde, le style de la chronique est entièrement retravaillé pour lui donner une inflexion élégiaque. Les événements anodins, les cris, la joie des jeux, le tragique de l’accident, la répétition des repas, les échappées frondeuses : tout advient et disparaît comme une récapitulation éternisée. On pense aux techniques narratives de Tolstoï, avec lequel Malick partage un certain mysticisme et une aura de gourou.
Comme dans Anna Karénine, les personnages sont plongés dans un clair-obscur vibrant, chaleureux et menaçant. Nous entendons, à la faveur de l’omniscience du créateur, leurs questionnements intérieurs (et ici, la rhapsodie des voix off est somptueuse), mais nous touchons aussi du doigt le mystère profond de leur destin guidé par quelque chose de plus grand qu’eux. Le regard se porte au cœur des entrailles vives, file hagard à travers les grottes du temps et s’échoue aux bords d’un abîme pulvérulent, où images et sons n’ont plus lieu d’être.
Depuis toujours, chaque plan de Malick est un capteur branché sur des forces telluriques, divines, verticales. Mais jamais il n’avait encore franchi le pas d’une représentation littérale de cet au-delà inhumain. Aidé par Douglas Trumbull, auteur des effets spéciaux de 2001, il plonge le spectateur dans un long bain sidéral, mélangeant prises de vue réelles (cascades, volcans, vues sous-marines…) et bidouillage de peintres post-Dali de l’ère iMac : «On a utilisé des produits chimiques, de la peinture, des teintures fluorescentes, de la fumée, des liquides, du dioxyde de carbone…» explique Trumbull dans le dossier de presse. (…) Peu importe, la tambouille philosophique phosphorescente de Malick n’a jamais été ce qu’il y avait de bouleversant chez lui. Non, c’est bien une fois encore la confiance totale, intransigeante et jupitérienne dans l’acte de filmer à perdre haleine, versant l’un dans l’autre tels deux philtres noirs les univers visibles et invisibles jusqu’au point d’éblouissement final. DIDIER PÉRON
******
On sait très peu de choses de Terrence Malick, qui s'est toujours entouré de mystère. Après des études très brillantes à la célèbre université de Harvard, il entame une carrière de journaliste et travaille notamment pour Life et le New Yorker. Attiré par le cinéma, il intègre le Centre d'Etude Avancées de l'American Film Institut, où il rencontre George Stevens Jr. et Mike Medavoy qui lui confie la réécriture du scénario de L'inspecteur Harry. Cette entreprise qui ne donnera rien au final lui fait sauter le pas de la réalisation. Il a alors 28 ans.
Son premier film, La balade sauvage (1974), est unanimement salué par la critique qui dira même que c’est le "film le plus maîtrisé depuis le Citizen Kane d' Orson Welles". Il y met en scène de nouveaux talents comme Martin Sheen et Sissy Spacek.
Quatre ans plus tard, il signe un chef-d’œuvre avec Les Moissons du ciel, qui révèlera le jeune Richard Gere. Ensuite c’est le silence radio : Terrence Mallick s’exile et se terre dans le mutisme le plus total, un silence qui durera... 20 ans.
On raconte ça et là qu’il aurait participé au scénario de Will Hunting, mais son retour est officiel en 1999 avec La Ligne Rouge, film adapté du roman de James Jones, et dont le casting donne le vertige : Sean Penn, Woody Harrelson, George Clooney, Adrien Brody, Nick Nolte, John Travolta, Jim Caviezel...
Déception pourtant, la sortie du Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg au même moment eclipsant le nouveau film de Malick. Il faut attendre encore sept ans pour voir de nouveau un film du réalisateur, avec Le Nouveau monde, mettant en vedette Colin Farrell.
Fidèle à sa culture du secret, Terrence Malick ne laisse pas filtrer grand chose de son projet suivant, Tree of Life, réunissant à l'écran Brad Pitt et Sean Penn, attendu pendant deux ans, changeant régulièrement de synopsis - de l'épopée cosmique embrassent toute l'histoire humaine au parcours du jeune Jack découvrant les affres de la vie en passant par l'animation de dinosaures. Espéré à Cannes en 2010, il est finalement prêt pour l'édition 2011 où il remporte la Palme d'Or.





















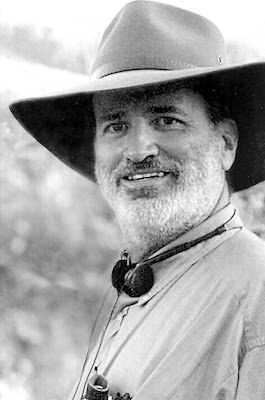





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire